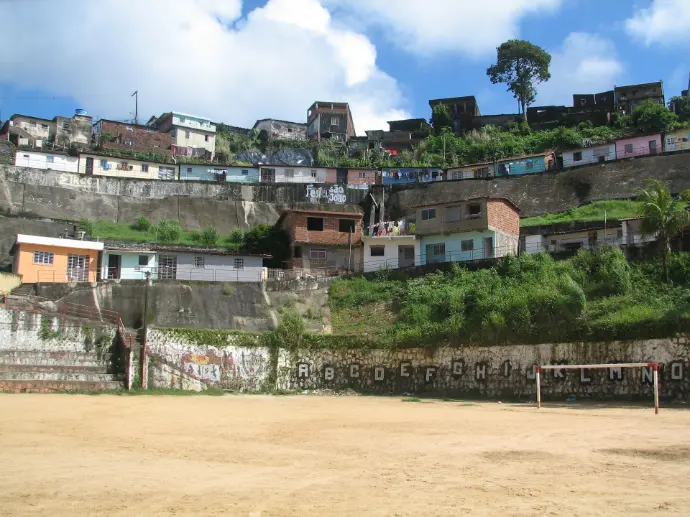La Chaire
Programmation
Depuis une vingtaine d’années, une injonction à la participation directe des citoyens marque les sociétés, que ce soit dans les démocraties dites avancées ou plus récentes, voire même dans les régimes autoritaires, alors que où l’impératif de la participation intervient en parallèle avec un discours de relégitimation des institutions, de consolidation et d’approfondissement des pratiques démocratiques et, plus encore, d’inclusion sociale, d’élargissement de l’accès aux droits de la citoyenneté et de redéfinition de l’appartenance aux communautés politiques (Dagnino, 2006; Jenson, 1997, 2007).
La définition des frontières et des contours de ce qu’on a aussi appelé les régimes de citoyenneté des sociétés contemporaines, s’inscrit un processus relationnel où interagissent acteurs institutionnels, politiques et sociaux au sein des institutions (Tilly, 1995; Oxhorn, 2007), notamment des institutions participatives qui, comprennent 1) les lois, règles et normes encadrant les pratiques participatives, 2) les mécanismes formels et institutionnels qui permettent de traduire ces règles, et 3) les pratiques informelles de participation et d’engagement citoyens. Ces espaces et pratiques de participation structurent en effet la relation entre les acteurs étatiques, sociaux et politiques et définissent au moins en partie les modalités d’accès à l’État.